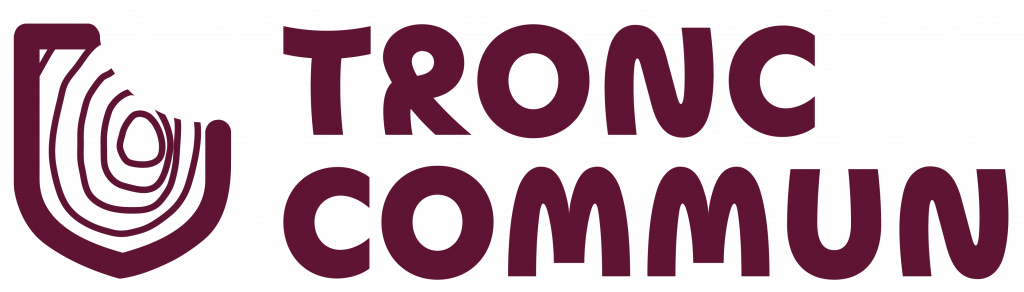En s’intéressant de plus près à l’animation des chartes forestières et aux dynamiques existantes au PNR des Boucles de la Seine Normande, nous avons rapidement identifié les comités de suivi de ces chartes comme des endroits pouvant générer quelques frustrations.
Depuis quelques années, les animateurs des chartes forestières du PNR des Boucles de la Seine, de Rouen Métropole et de l’Agglo Seine Eure (… et bientôt du Havre), on mit en place des comités de suivi inter-chartes, partant du constat que les partenaires mobilisés (ONF, CNPF, DDTM, Fibois …) étaient les mêmes, leur proposer un temps 3-en-1 ne faciliterait que leur implication. Depuis lors, chaque territoire de charte assure l’organisation logistique du comité à tour de rôle.
Nous faisons l’hypothèse que ces temps pourraient être des occasions de rendre la dynamique forestière plus collective et partenariale ; pourraient permettre de sortir de l’exécution du plan d’actions pour prendre un peu de recul sur les évolutions dans lesquelles elles s’inscrivent et les paris auxquels elles contribuent ; et pourraient être investis comme de vrais temps stratégiques.
Nous avons donc proposé à ces trois structures, ainsi qu’à l’Union Régionale des Communes Forestières de Normandie un temps de mise à plat de leur comité de suivi pour en comprendre tous les ressorts.
Du comité de suivi au COPIL, il n’y a qu’un pas ?
Nous nous sommes nourris pour cette session des réflexions entreprises par l’agence Partie Prenante dans COPILOTE, qui propose de mettre les comités de pilotage sur l’établi : de la difficulté à donner de la places au débat contradictoire, en passant par la succession de présentations descendantes, ou encore en observant les jeux de postures, inutile de chercher très loin pour constater qu’une marge d’amélioration est possible dans ces instances. Et s’il est bien question de régler le « comment ça fonctionne ? », encore faut-il sortir du flou sur sa fonction et se demander « à quoi c’est censé servir ? »
… Et si on se posait les mêmes questions pour les comités de suivi ? Sur le papier, les constats ne sont pas si différents. Et même s’il ne s’agit pas à proprement parler d’un COPIL, le fait de le nommer comité de suivi en dit déjà quelque chose sur le renoncement à faire un endroit de pilotage : « La question du nom traduit l’ambiguïté du positionnement. C’est à la fois un comité technique et un temps pour les élus. Le flou sur le nom traduit la tentative d’articuler les objectifs de chacun ».
Décortiquer le comité de suivi en trois étapes
> Qu’est ce qu’il s’y passe et qu’est ce qu’on aimerait qu’il s’y passe ?
Les comités de suivi rassemblent une 40 aine de personnes. Ils sont introduits par l’élu.e référent.e-forêt accueillant (à tour de rôle sur les 3 territoires). La matinée est consacrée à un temps en plénière, l’objectif est avant tout le partage d’informations. Chaque charte est racontée par la présentation de quelques actions qui se sont déroulées dans l’année (allant de « 3 ou 4 pour les détailler un peu plus », à « une dizaine pour balayer tous les axes »), les équipes sont autonomes pour préparer ces présentations, ce qui explique leurs natures un peu hétérogène. Les actions qui sont répliquées dans plusieurs territoires sont mises en avant. Les interactions avec le public de participant.e.s sont variables. L’après-midi permet d’illustrer ce qui a été présenté le matin, grâce à une visite de terrain (visite d’une entreprise, d’une forêt FSC …), très appréciée des élus notamment. Les présentations de la matinée sont ensuite envoyées aux partenaires, accompagnées parfois d’un compte-rendu des échanges.
Ce temps bien huilé n’est pas sans générer quelques frustrations du côté des animateurs des chartes, parmi lesquelles :
- la grande densité d’informations partagées et le peu de place faite aux interactions : « il y a peu de place pour les échanges, c’est très dense, même si ça donne un bon panorama des actions » ; « Partager de l’information est important, mais quand on le fait on sent quand même une forme de passivité dans la salle… » ;« j’aimerais que ce soit plus participatif, mais j’ai l’impression que ce n’est pas ce que viennent chercher les participants. Les gens ne se plaignent pas et ne manifestent pas d’autres attentes, donc globalement c’est que ça leur va … » ;
- le manque de valorisation et de mesure d’impact des actions communes aux territoires : « on ne voit pas vraiment la plus-value des actions qui se retrouvent sur plusieurs chartes, elles sont juste présentées plusieurs fois » ;
- l’absence de temps plus réflexif permettant d’alerter sur les difficultés rencontrées « Il n’y a aucun moment où on met à plat les freins qu’on a nous en tant que techniciens pour faire les actions » ;
- le manque d’inspiration au-delà du périmètre des chartes : « Ce qu’on fait très peu c’est d’aller voir des choses qui se font en dehors du territoire » ; « ça pourrait être un lieu pour présenter d’autres actions menées ailleurs, par les partenaires ».
- la substitution de temps entre techniciens pour évaluer les actions communes par des considérations organisationnelles et logistiques pour préparer la journée.
Si de bonnes choses sont tout de même à garder dans cette journée car jugées essentielles par les animateurs (comme la présentation des actions), le risque est plutôt que son format s’épuise dans le temps. Comment rendre cette journée plus contributive et moins descendante ? Comment remettre un peu de stratégie et faire de la présentation factuelle des actions un moyen de repolitiser le sujet forestier ?
> Quelle est ou devrait être la véritable fonction de ce comité ?
Ce comité est un temps de mise à jour sur les projets déployés dans les chartes : c’est le seul temps de l’année où il y a un temps d’avancement sur les chartes, et les animateurs y tiennent (« je tiens très fort au côté information »).
Ce comité devrait être un temps plus politique : « une charte forestière est un outil de territoire, ça ne peut se faire qu’avec les élu.es. Pour moi c’est un outil politique à la base. Et c’est devenu un outil technique… On a perdu la vision politique des choses, parce que c’est confortable de l’animer comme ça ». Dans l’état actuel du comité, pensé comme un temps pour les élus, il n’y a aucun temps de discussion sur les attentes pour le territoire.
Au fil de l’échange, si les animateurs de chartes n’expriment pas tout à fait les mêmes frustrations c’est probablement qu’ils n’ont pas les mêmes attentes vis-à-vis de ce comité. C’est ce que traduit déjà le flou sur le nom de cette instance. Et quand il y a un flou, il y a un loup ! « le problème c’est quand on est pas forcément sur les mêmes pas de temps entre les chartes, donc les attentes ne sont pas forcément les mêmes ». Si l’idée est louable de vouloir faire un temps collectif, le risque n’est-il pas de tenter de contenter tout le monde au détriment des besoins de chaque équipe territoriale ? Comment repenser ou réaménager ce temps afin que chacun en tire profit ?
> Qu’attend-on des participant.es présent.es ?
Finalement, c’est autour du rôle de l’élu.e que nous avons le plus échangé. Mais la difficulté est de trouver la bonne articulation entre concernement territorial et stratégie inter-territoriale : « Un élu connaît les enjeux de son territoire, mais prendre un peu de recul et faire travailler des élu.es sur des enjeux partagés, à l’échelle de plusieurs territoires, c’est pas évident pour eux » ; « il faudrait que nos élu.es soient déjà impliqués pour la charte elle-même ; puis voir après s’il y a un axe stratégique plus large. Donc en premier lieu il faut consolider une base solide à une échelle territoriale avant de travailler l’inter-territorial ».
Une journée de comité de suivi pourrait peut-être articuler des temps en comité resserré autour de chaque charte, et des temps plus collectifs ?
A cela s’ajoute un besoin de clarification à propos « des élu.es » dont on parle : est-ce qu’il s’agit seulement des référents forêt de chaque collectivité, ou bien de tous les élu.e.s ? L’attente n’est sans doute pas la même envers tous.
Autre attente, plus difficile à mesurer, envers les participant.es : « pas forcément de contribution directe, mais que ce temps nourrisse chez eux de nouvelles actions, de nouveaux liens et partenariats ». Comment ne pas uniquement projeter ces nouvelles dynamiques comme bénéfice co-latéral des comités, mais tenter de les mesurer, de les rendre visibles ? Voir comment cela pourrait nourrir la dynamique partenariale inter-chartes ?
Quelques fils à tirer pour la suite :
- Se poser le même type de questions, mais avec les élu.es pour connaître la manière dont ils vivent ces comités, et ce qu’ils pourraient en attendre ;
- Faire des divergences d’attentes et d’ambition des porteurs de charte un vrai sujet de travail pour que chacun.e y retrouve un intérêt dans ces comités, et éviter de contenter un peu tout le monde, mais totalement personne ;
- Mettre à profit les liens de confiance entre les animateur.ices de chartes pour renforcer le processus de coopération : par exemple se préparer au comité de suivi (expliciter les intentions, les finalités, les enjeux collectivement), plutôt que préparer le comité de suivi (déroulé et logistique, où chaque animateur.rice prépare sa présentation avec ses propres intentions) ;
- Aborder différemment le prochain comité de suivi : Et si le prochain comité était justement l’occasion d’expliciter les intentions et besoins de chacun.e des participant.es, de leur donner davantage la parole, de dessiner ensemble à partir de là un autre visage de ce comité, de s’interroger sur ce qui se passerait si on ne faisait plus de comité, pour possiblement mieux faire ressortir ce à quoi on tient ?