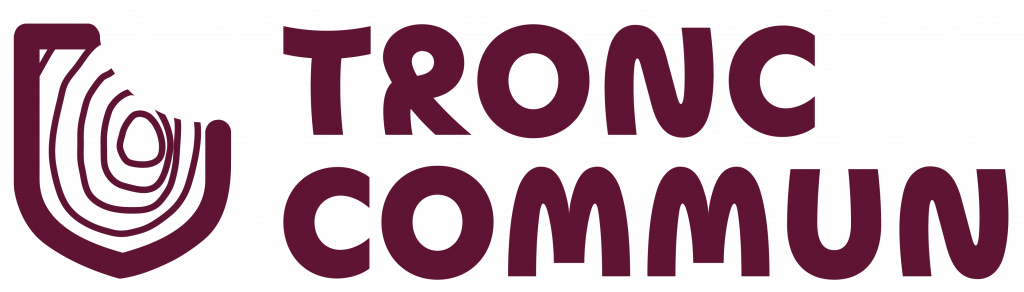Six mois après un premier temps de croisement entre les lauréats de l’AMI « Concertation et Multifonctionnalité des forêts », nous revoici rassemblés pour un tour d’actualité avec les lauréats. Pour la plupart, les projets sont maintenant bien démarrés, et les premiers enseignements de ces démarches commencent à remonter. On vous partage ici quelques unes des réflexions que l’on a pu glaner.
Un sentiment partagé d’être monté en compétences sur les méthodes de dialogue et de facilitation …
Pour la plupart des lauréats, mettre en place une concertation est assez nouveau, et cet AMI a donc été une bonne occasion de se former à ces méthodes de dialogue, auprès de prestataires extérieurs. Pour autant :
- Concerter n’empêche pas de penser le format : le CNPF en PACA a mis en place une série d’ateliers de concertation, mais n’est pas pleinement convaincu que ce format ait été celui qui convenait le mieux au territoire et au projet en question : « il aurait été mieux d’avoir un binôme mobile« , pour concerté à des échelles plus petites mais en plusieurs occurrences ;
- Concerter ce n’est pas faire collectif : en Occitanie, la création du conseil de développement forestier nécessite un vrai temps d’embarquement, de mise en liens, d’interconnaissance … et ça, ça prend du temps (et c’est presque un projet en soi). Créer les conditions d’un débat non conflictuel est primordial mais s’inscrit dans le temps long. C’est un préalable dont il faut prendre soin pour aborder des sujets plus controversés ;
- Concerter, c’est endossé une posture de neutralité : et ce n’est pas le plus simple pour les porteurs de projet (« le rôle d’animateur est parfois difficile à tenir au vu de la neutralité que ça demande… on doit sans cesse rappeler que les COFOR sont neutres« ).
La mobilisation des citoyens, un parti pris de plusieurs projets …
Il n’est pas toujours évident de mettre autour de la table professionnels et citoyens sans que soit reprochée à ces derniers leur manque d’expertise. Du côté du Syndicat Mixte destination Brocéliande, les propriétaires forestiers ne voulaient pas qu’ils participent à la concertation au même titre que les autres acteurs de la filière. Si la demande a été entendue, des ateliers citoyens ont été mis en place en parallèle pour accueillir les préoccupations de ces derniers, et leurs donner de la visibilité dans les discussions entres parties prenantes plus habituelles et dans l’élaboration du plan d’action.
Pour le projet « Relais des bois » dans l’Ain, l’enjeu est clairement affiché de susciter de l’adhésion chez les habitants, pour constituer un réseau d’ambassadeurs. Malgré des efforts mis sur la communication pour mobiliser largement les habitants à des évènements, seule une petite dizaine se sont portés volontaire pour endosser ce rôle (sortes d’intermédiaires entre les citoyens et les professionnels de la filière). Les porteurs de l’AMI s’interrogent sur la possibilité de faire vivre un réseau dans le temps (en terme de temps, d’implication demandée, de renouvellement des ambassadeurs …).
Capitalisation et pérennisation ?
Les projets s’approchant doucement de leurs fins, l’heure est à la capitalisation des enseignements. Du côté du pacte forêt-Z, il est prévu de rédiger une forme de pacte/charte à l’échelle du territoire pour les forêts de demain (une sorte de nouveau récit), alimenté par une recueil de bonnes pratiques et d’usages ; pour diffuser la création d’un conseil de développement forestier à d’autres communes d’Occitanie, les communes forestières (COFOR) travaillent à la rédaction d’un guide méthodologique et de conseils pour cultiver une posture de neutralité ; en Bretagne, le consortium (et notamment le Syndicat mixte destination Brocéliande) réfléchit à la création d’un évènement type « fête de la forêt », pour offrir des occasions aux parties prenantes de se recroiser et cultiver les liens créés entre les structures … et à terme, mettre en place un véritable Parlement de la forêt.
De notre côté, nous nous interrogions sur la possible pérennisation (peut-être sous une autre forme) des consortiums établis pour l’AMI. Sont-ils des bases solides pour établir des stratégies forestières collectives ? Porter collectivement des défis que traversent et traverseront les forêts dans un contexte de changement climatique ? Mais ce pose alors la question de la légitimité de leur animation pour les pilotes des projets, au delà du mandat qu’ils ont dans le cadre du cet AMI … pas simple !
Nous avons conclu avec les lauréats présents à cet échange qu’il serait intéressant de se revoir dans 1 an, pour voir les traces et les impacts qu’auront laissé ces démarches. Le rendez-vous est pris ! En attendant, on continuera à suivre d’un œil ce qui se passe ici et là !