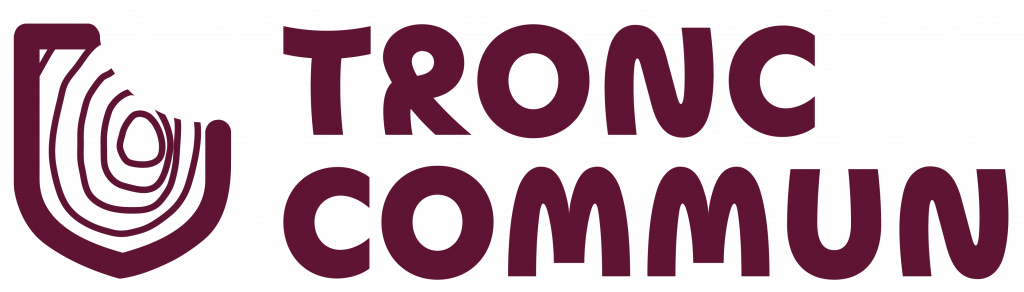Journal de Bord #2 – Du plan de gestion forestière concerté à la coopération
Le 17 mars se tenait à La Vigotte Lab un atelier dans le cadre du programme Dominos, un programme de recherche-action mené par AgrosParisTech, animé ici par le chercheur Maxence Arnould, qui vise à co-construire une méthode de planification forestière participative, tournée vers une bioéconomie circulaire, durable et ancrée dans son territoire. Objectif du jour : définir, avec la petite trentaine de participant.e.s de divers horizons présent.e.s, les itinéraires sylvicoles de plusieurs parcelles de la forêt du hameau. Pour les moins familiers du champ lexical de la gestion forestière – comme nous -, un itinéraire sylvicole c’est un peu comme un fil rouge de gestion forestière, une projection de ce qu’on voudrait faire d’une parcelle en pensant les interventions à réaliser dans les prochaines années. Comme point de départ les participant.e.s pouvaient s’appuyer sur des diagnostics (techniques, écologiques, et participatifs ..) de ces parcelles élaborés au cours des mois précédents.
Au delà de cette phase de co-construction des itinéraires (ce qui n’est pas du tout une obligation pour les propriétaires privés soit dit en passant), l’idée est aussi de rassembler un vivier d’acteurs dans une démarche de coopération plus pérenne, pour prendre soin de la forêt, et identifier justement quels pourraient être les rôles des un.e.s et des autres.
Entre les lignes, il s’agit de rendre opérationnelle l’idée d’un commun forestier sur le hameau ! D’où l’intérêt de mettre les pieds dès à présent dans ces ateliers pour déjà dessiner des pistes de travail pour faire advenir cette coopération désirée !





Rendre visible l’implicite
Qui dit commun, dit définir des modalités qui permettent de prendre soin collectivement de la ressource, et donc, faire un pas de côté par rapport au cadre réglementaire de la propriété privée et des prérogatives associées. A La Vigotte Lab, on projette de faire de la forêt un objet de coopération entre parties prenantes. Mais bon, aussi louable que soit l’intention, la coopération, ça ne se décrète pas ! Alors avant de regarder comment outiller au mieux des dynamiques de coopération, on a eu envie de regarder celles qui peut-être existent déjà (qu’elles soient formelles ou informelles).
Pourquoi les gens qui constituent le tour de table sont-ils là aujourd’hui ? En quoi cela résonne-t-il avec certains de leurs intérêts propres ? Pourquoi aurait-ils et elles envie de s’investir davantage ? On avait une idée en tête : rendre visible ce qui est implicite, ou du moins, qui n’est pas connu ou identifié par tout le monde. On avait prévu quelques temps largement inspirés d’une initiation à la maturité coopérative que nous avons suivi auprès de l’Institut des Territoires Coopératifs :
- Rendre visible les liens entre les participant.e.s sous forme d’une cartographie d’acteurs (mais en version sensible, avec un supplément d’âme). Révéler les espaces de coopération ou collaboration permet aussi d’identifier les espaces « ressources » sur lesquels s’appuyer ;
- Prendre soin des besoins et inspirations individuelles dans la dynamique collective, en se demandant par exemple : qu’est-ce que je fais là, qu’est ce que je viens chercher ; requestionner l’intérêt de la démarche …
Donner de la place aux temps de prise de recul : laisser les participant.e.s exprimer ce qui les a nourri dans une journée comme ça, avec quoi ils et elles repartent et ce qui leur a peut être manqué.
Dans les faits, voilà ce qu’on a pu tester
Si de notre côté nous avions quelques attentes, consistant principalement à collecter de la matière pour construire les futurs temps dédiés à la coopération, les attentes étaient grandes aussi du côté de Dominos et de l’élaboration des itinéraires sylvicoles … Et au final, impossible de tout faire rentrer dans une journée.
Pour cette fois, on a du se contenter de la cartographie des liens (ce n’est que partie remise pour le reste). Tout au long de la journée, nous avons invité les participants à venir se positionner sur un poster, et à qualifier les liens qui les reliaient aux autres protagonistes de la journée. Si la plupart ont joué le jeu … Le test de cet outil d’explicitation reste quand même un semi flop. Plusieurs facteurs peuvent jouer : notamment la difficulté d’animer les temps « off » (l’accueil café, les pauses …), qui comme leur nom l’indique, servent aussi à souffler et sont des espaces de discussions plus informels mais tout aussi essentiels à la journée. A cela s’ajoute le fait que cette cartographie nécessite des itérations, que les participant.e.s se positionnent au fur et à mesure de la journée, il faut donc y revenir régulièrement pour qualifier les liens avec les derniers arrivés …


Disons que c’est une première base : cette cartographie pourra être enrichie dans de futurs temps, ou être un prétexte à reprendre contact avec certain.e.s participant.e.s. L’après-midi était dédié aux itinéraires sylvicoles, dans un format worldcafé. L’occasion pour nous de laisser traîner des oreilles attentives, au gré du ballet des groupes allant de table en table (chaque table se consacrant à une parcelle particulière), en écoutant particulièrement si s’y exprimaient des pistes ou intentions de coopération. Là encore, la matière collectée est un peu faible à ce stade, sauf peut-être du côté de l’enjeu de « lisière forestière » (espace tampon entre la forêt et un autre milieu), où la coopération s’est imposée comme indispensable pour faire perdurer les co-bénéfices induits de part et d’autre (mais avec la limite de l’exercice s’agissant de La Vigotte Lab, le propriétaire étant le même de part et d’autre de la lisière … donc la coopération plus naturelle) ; d’une potentielle conflictualité avec la police de l’eau, ou encore du besoin de « donner des clefs de lecture des choix sylvicoles » au grand public.



Enclencher la suite
Prochaine étape : consacrer un atelier à ce sujet de la coopération et de l’engagement… Mais d’ici là, il y a sûrement tout un tas de préalable à reposer :
- Par exemple : travailler le cadre de la coopération avec les propriétaires : est-ce qu’il s’agit ici de renoncer à certaines prérogatives ? Quelles marges de manœuvre pour celles et ceux qui s’impliqueront ? Comment faire un pas de côté par rapport au droit de propriété … Tout en restant dedans (un jeu de contorsionniste…) ?
- Mais aussi enquêter sur la future « communauté » qui s’impliquerait autour de la forêt : sur qui s’appuyer, pour quoi ? Qu’est-ce qui faciliterait l’engagement d’un acteur a priori « extérieur » ? Comment construire un espace de coopération qui tienne dans le temps, et puisse survivre aux départs de certain.e.s, ou à l’arrivée de nouveaux contributeurs et contributrices … ?
Tout un chantier qui s’ouvre ! A suivre